Jean Birnbaum, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, Paris, Le Seuil, 2016, 239 p, 17 €.
Adrien Candiard, Comprendre l’islam ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien, Flammarion, 2016, 123 p, 6 €.
Communio : L’islam, XVI, 5-6, septembre-décembre 1991.
Islam, islamisme et l’incompréhension théologique
Le premier ouvrage étudié a été rédigé par le directeur du Monde des livres, Jean Birnbaum, entre les attentats de Paris en novembre 2015 et ceux de Bruxelles (mars 2016). Ce livre montre la rupture entre les doxas politiques et la compréhension des théologies quelques soient les confessions religieuses. L’auteur, sur le lien entre islam et islamisme, place la gauche devant la responsabilité du ‘silence’ comme si elle ne comprenait pas, ou plus, les enjeux de la question. Il est probable que cette interrogation puisse s’étendre à toutes les tendances politiques. Toutefois, la spécificité de la gauche réside dans le fait qu’elle est héritière de la pensée de Karl Marx qui, sur le sujet religieux, est plus complexe qu’elle n’y parait. Le père Jean-Yves Calvez, sj, considère que « le problème religieux se présente au point de départ de la pensée marxiste » (p 131). Jacques Derrida (p 133) affirme que la religion a une place centrale dans l‘imaginaire, le projet théorique et la promesse politique de Marx. Cela fait (p 140) « de la religion, non un vestige du passé, mais le grand enjeu de l’avenir ».
Aux thèses de ce livre, nous croisons celles du père Adrien Candiard, op. Son ouvrage, issu d’une conférence, se veut une approche de l’islam et de l’islamisme contemporains. Cette conférence a été publiée dans La Documentation catholique et est disponible à la Médiathèque Mgr Depéry. Nous ajoutons à cette analyse des éléments provenant d’articles de la revue Communio, qui en 1991 consacrait un numéro à l’islam et d’autres issus d’un article de Mgr Henri Teissier, alors archevêque d’Alger (Nouveaux courants dans l’islam, Études, avril 1992, p 447-456).
Jean Birnbaum (p 23) souligne les difficultés « à combattre l’amalgame entre islam et terrorisme, et pour cela [à] dissocier la foi musulmane de la perversion islamiste ; d’autre part, [à] prendre pleinement en compte la dimension religieuse de la violence jihadiste ». En effet, selon lui (p 36), la culture de la gauche française s’est « largement bâtie sur une volonté d’éradication du religieux, et donc aussi une tendance à l’escamoter ». Il utilise (p 32) les termes d’« exculturation religieuse de nos sociétés contemporaines » en reprenant Denis Crouzet et Jean-Marie Le Gall. De son côté, Adrien Candiard (p 14) fait le même constat. Une part des experts médiatiques répète que « le terrorisme n’a rien à voir avec l’islam […] avant d’ajouter avec une consternation sincère : ‘ces gens n’ont jamais lu le Coran’ ».
Jean Birnbaum (p 43) soutient que « pour lutter contre le jihadisme, plutôt que d’affirmer qu’il est étranger à l’islam, mieux vaut admettre qu’il constitue la manifestation la plus récente, la plus spectaculaire et la plus sanglante de la guerre intime qui déchire l’islam ». Il ajoute que (p 55) « parmi les nouveaux penseurs de l’islam, aucun ne considère que cette religion est réductible à l’islamisme. Mais aucun non plus ne songerait à nier que l’islamisme en est la pathologie violente, et le jihadisme l’avatar meurtrier ». Jean Birnbaum (p 62), à l’image des défunts Mohammed Arkoun et Abdelwahab
Meddeb, souligne que, « autant il est odieux de réduire l’islam à ses perversions sanglantes, autant il est absurde d’affirmer que ces perversions n’ont ‘rien à voir’ avec la tradition musulmane et son devenir contemporain ». Jean Birnbaum (p 232), sur ce point, reprend Claude Lefort qui « n’a jamais cessé de creuser les contradictions de la politique […] Il avait bien conscience que toute pensée politique charrie des concepts et une mémoire issus de l’univers théologique ».
Adrien Candiard (p 38) s’interroge sur les différences entre islam et islamisme, « l’islamisme […] est un des visages que prend l’islam d’aujourd’hui ». Birnbaum, reprenant Gilbert Achcar (p 158) s’interroge sur le fait que ce qui est constitutif de l’intégrisme dans la plupart des religions « joue dans l’islam institutionnel un rôle omniprésent ». À la page 58 déjà, Jean Birnbaum avait développé une idée semblable s’appuyant notamment sur Patrice Maniglier, lui-même cité plusieurs fois, notamment p 34. Jean Birnbaum (p 72 et 96) explique le déni du religieux par la gauche, à partir du soutien par une part de celle-ci au Front de libération national durant la guerre d’Algérie. Elle a alors oblitéré le rapport du FLN avec l’islam (p 90) et le fait que le « pionnier du nationalisme algérien », Messali Hadj, fondateur notamment du Mouvement national algérien, est un religieux. Elle n’a pas compris (p 78), également, que El Moudjahid, le titre du journal du FLN, signifie le combattant de la foi : cela doit aussi nous interroger sur l’usage du mot jihadiste si répandu en France tout en convenant que la notion de jihad n’est pas réductible à celle de terrorisme. Il faut compléter le constat de Jean Birnbaum par un exemple parmi d’autres. L’ordonnance du 7 mars 1944 est bien relative « au statut des Français musulmans d’Algérie » (Journal officiel de la République française, édition d’Alger, du 18 mars 1944) qui appuyait ainsi une définition du « Français » sur un statut religieux. En effet, la loi du 9 décembre 1905 ne s’appliquait pas hors de l’hexagone avant la décolonisation : la gauche française n’écarte donc pas le religieux de toutes ses réflexions à cette époque.
Jihadisme, motivation et espérance
Jean Birnbaum cite de nombreux philosophes, dont peu sont vivants aujourd’hui. C’est par exemple le cas de Walter Benjamin décédé en 1940 (p 222-224, 232). Il utilise notamment les travaux de Michel Foucault à plusieurs reprises, comme aux pages 117 et 232. Pour Foucault (p 108), dans la révolution iranienne (1978), la religion est le « vrai visage » de la révolte et (p 184) il ne faut pas réduire cette révolution à des causes économiques et sociales. Il est nécessaire de prendre en compte la dimension spirituelle. Adrien Candiard confirme cela (p 36, 43-44) en soulignant « la limite des explications purement géopolitiques » et socio-culturelles. Et Birnbaum (p 184 et suivantes) d’affirmer que le jihadisme représente une « espérance si puissante qu’elle emporte par milliers des jeunes du monde entier, capable de tout sacrifier en son nom » et qu’il répond par une logique trans-nationale à la globalisation « bourgeoise ».
Jean Birnbaum (p 19) présente les jihadistes comme ayant une communauté de mots et de gestes quelques soient les lieux et les milieux dont ils sont originaires et où ils frappent. Ils ont une même certitude messianique, un même discours et les mêmes traités théoriques dans leurs bibliothèques, à l’opposé de la diversité musulmane. Ils vivent (p 209) l’islamisme comme une ascèse individuelle (dont nous pourrions dire qu’elle a une visée rédemptrice) destinée (p 27-28) à défendre un Dieu unique, protéger son image, travailler à son triomphe et bâtir son royaume. Cela les inscrit dans une assemblée, sous une autorité transcendante. Toujours selon Jean Birnbaum (p 190), si la motivation du combattant est « l’appétit de détruire […] c’est aussi la quête de justice, leur arme absolue, c’est l’espoir », l’enthousiasme. L’amour « pour les gens qui sont ignorants, qui ne savent pas la vérité, [l’] amour pour les gens persécutés ».
La nature de l’islamisme
Mais quelle est la nature de cette espérance ? Elle a, du point de vue de Jean Birnbaum, un aspect politique totalitaire. À la page 173, il constate que l’islamisme, au pouvoir, élimine la gauche politique. À ses yeux, c’est un mouvement porté « par des forces sociales puissantes, à la fois hypermodernes et ultrabourgeoises » et qui (p 151) « doit être considéré comme une utopie petite-bourgeoise, qui vire parfois au puritanisme répressif, parfois à la rébellion contre l’ordre en place ». La violence islamiste s’inscrit dans (p 218) « Les formes les plus extrêmes du religieux [qui] prennent aujourd’hui leur revanche. Elles englobent dans une même haine révolutionnaires bourgeois et ouvriers, démocrates libéraux mais aussi socialistes. Elles visent avec la même virulence tous ceux qui ont voulu nier l’autonomie du religieux ». Au final, (p 150) l’islamisme a la « volonté de bouleverser la société » dont elle est un produit.
Rémi Brague (p 17, Un dialogue entre qui ? Communio, p 6-27) soutient un point important. « Les ‘intégristes’ musulmans ne refusent aucunement la technique moderne, qu’ils acceptent au contraire volontiers ». Cette idée existe déjà chez Jacques Derrida repris par Jean Birnbaum (p 230) qui pense que pour comprendre le « retour du religieux », il ne faut pas « opposer aussi naïvement la Raison et la Religion […] la Modernité technologique et la Religion ». Cette analyse rejoint celle (p 226) sur la guerre civile en Algérie dans les années 1990 où l’hyper sophistication côtoyait la violence archaïque.
Pour Adrien Candiard (p 55-56), l’opposition, au sein de l’islam, n’est pas entre des traditionnalistes rétrogrades et des modernisateurs éclairés, mais à l’intérieur du sunnisme issu des empires arabe et ottoman, ayant conçu des outils de gestion de la diversité notamment dans les écoles juridiques. Ce modèle s’effondre avec le « monde ancien » : c’est « le génocide des Arméniens » (http://livresadecouvrir.blogspot.fr/2015/08/1915-2015-bibliographie-selective-sur.html). Guy Monnot (p 29, Ce que l’Islam n’est pas, Communio, p 28-41) explique, en outre que « la communauté musulmane […] s’est ordinairement considérée comme distincte et indépendante en tant que société terrestre et temporelle ».
Islam contemporain : unité et division
Adrien Candiard (p 21) souligne qu’il ne faut pas oublier « la diversité culturelle de cette religion mondiale » due à sa présence en de nombreux espaces géographiques. La diversité (p 22 et 41) est également théologique entre chiisme et sunnisme. Des divisions existent à l’intérieur du sunnisme par exemple entre wahhabites d’Arabie et confréries soufies du Sénégal. (p 67) Le salafisme, lui, « rêve de musulmans chimiquement purs ». Cependant (p 40), cette diversité ne doit pas être un prétexte pour nier une unité réelle.
Cette unité est soulignée par la fraternité et la solidarité au sein de la communauté. Sur ce point de la solidarité, le père Claude Gilliot, op (p 141, Islam et pouvoir, la commanderie du bien et l’interdiction du mal, Communio, p 127-152), dans une note, indique que « l’argent et les activités ‘caritatives’ sont l’un des nerfs de l’activisme intégriste » via l’Arabie Saoudite notamment.
Cette fraternité et cette solidarité ne sont pas exclusives de l’équité envers les non-musulmans n’ayant pas combattu les musulmans, leur religion, et n’étant pas à l’origine de leur exode selon Jacques Jomier op (p 71, Chrétiens et musulmans, vivre ensemble, Communio, p 63-80 en s’appuyant sur Coran, 60, 8-9). Il souligne (p 70) que la Oumma, communauté musulmane, est dans le Coran (5,56) aussi appelé peuple/parti de Dieu (Hezbollah). La solidarité islamique peut s’assimiler à « un nationalisme supérieur, qui ne serait basé ni sur la langue, ni sur le territoire, mais sur la foi ».
Jean Birnbaum (p 51) analyse le réveil, Nahda, sur la longue durée : « l’islamisme est né au XIXe siècle, en réaction aux tentatives de réforme de la Nahda, et la virulence actuelle signifie l’échec de ces tentatives. En cela, les mouvements islamistes sont moins ‘archaïques’ que postmodernes ».
Maurice Borrmans (p 92-93, Dialogue entre Chrétiens et Musulmans : pessimisme et espérance, Communio, p 81-98) estime que le réveil religieux vient compenser les frustrations provoquées par la lenteur de l’Etat à résoudre les difficultés du quotidien alors que « la construction nationale de l’état moderne nécessite pour le pouvoir en place une légitimité offerte seulement par « l’idéal islamique de la loi religieuse ».
De la même manière, Adrien Candiard souligne cette place de la théologie de l’islam « comme religion totale, englobant tous les aspects de la vie » (p 20) en la considérant comme irréalisée puisqu’il faut tenir compte de tous les aspects psychologiques, sociaux, personnels. (p 19) « la première erreur […] c’est croire d’abord que les musulmans ne sont que des musulmans ; que leur identité religieuse recouvre tout le reste : opinions politiques, solidarités nationales ou ethniques, culture, fantaisie… » La même idée se trouve chez Rémi Brague (p 9-10) pour lequel identifier les musulmans à leurs habitus « c’est déjà presque raisonner comme les ‘islamistes’ ». Il faut noter que cette conception d’une théologie musulmane totalisante est défendue à la fois par les islamistes et par ceux qui confondent islam et islamisme.
Claude Gilliot (p 146), lui, à partir d’un exemple des VIIIe-IXe siècles après Jésus Christ, conclut « à une certaine distinction entre le spirituel et le temporel, des conflits surgissant constamment entre les deux ordres, comme il en existe dans toutes les sociétés ». Le père Claude Gilliot avait déjà écrit (p 144) qu’il lui paraissait « exagéré de parler d’une confusion absolue du politique et du religieux » et, a contrario, que la séparation du temporel et du spirituel n’est pas sans nuance.
Selon Adrien Candiard (p 88), un seul verset du Coran (4, 59) permet d’appuyer les théories politiques. Il faudrait y ajouter au moins les versets 8 et 9 de la sourate 60, cités par Jacques Jomier, sur la place des communautés à l’intérieur de la cité et, par ailleurs, analysés récemment par l’imam Chafik Jaradi dans Perspectives et réflexions (n° 4-2016, p 56-59). Mgr Henri Teissier, avec ces deux versets en filigrane, suit l’analyse de Mohamed Cherif Ferjani qui précise que « pour les islamistes, il ne saurait y avoir d’égalité entre les musulmans et les non-musulmans. La fraternité n’est concevable qu’entre les ‘croyants’, qu’ils réduisent abusivement aux seuls musulmans, et parmi les musulmans, à ceux qui partagent les mêmes conceptions que les leurs ».
Le 59e verset de la sourate 4 prône l’obéissance au prophète de l’islam et « à ceux d’entre-vous qui détiennent l’autorité » précise Adrien Candiard. Les différends doivent être portés devant Dieu et le prophète. Le calife (p 89-90) gouverne au nom d’une loi religieuse énoncée et mise en forme par des juristes, les ulémas, qui s’organisent d’une manière indépendante, à partir de la période abasside (750-1258 ap. JC). « Dès lors, on a, dans la pratique une véritable distinction entre le pouvoir, qui appartient au calife, et la religion qui est dominée par les ulémas » vers la moitié du IXe siècle (p 92-95). De surcroît, les sociétés musulmanes vivent de façon habituelle sans calife. Les sultans ottomans s’attribuent le titre de calife à l’époque moderne. Le parlement turc vote en 1924 la fin de cette institution. « Cette vacance » va alors alimenter l’imaginaire d’un islam politique « dont l’Etat islamique nous montre aujourd’hui la puissance symbolique ». Car souligne Roger Arnaldez (p 101, la théologie (Kalâm) et la philosophie (falsafa) en Islam, p 99-118), « il ne saurait exister d’islam sans un […] territoire administré selon la loi musulmane, en opposition avec le […] territoire de la guerre, c’est-à-dire les pays des infidèles soumis à des lois humaines imparfaites, ou dans le cas des nations juives ou chrétiennes, régis par les lois ‘abrogées’, celles de Moïse et de Jésus »
C’est au fond la description de la force du salafisme qui, selon Adrien Candiard (p 80), souhaite construire une société « sur le modèle de la communauté primitive de Médine ». Le salafisme le plus radical peut même s’opposer au salafisme lorsque celui-ci est au pouvoir, comme en Arabie Saoudite.
Borrmans (p 81) souligne en 1991 le paradoxe d’un parti politique, socialiste et laïque dont un leader (Saddam Hussein, 1991, sunnite) « appelle les masses musulmanes au jihad pour mieux défendre les terres d’islam et chasser les gouvernements corrompus de la péninsule arabe ». C’est le même paradoxe qu’effleure Adrien Candiard (p 52-53), dans la description de la Syrie où Bachar al Assad (issu d’une autre branche du parti Bass auquel appartenait Saddam Hussein) s’appuie sur les dignitaires religieux chiites alaouites.
Jihad
Selon Adrien Candiard (p 23-24), la définition du jihad varie. Pour un salafiste, il est l’obligation individuelle de tuer les non-musulmans et les faux-musulmans. Un juriste classique dira qu’il est un devoir collectif, le plus souvent défensif, qui ne peut être accompli que par une autorité politique légitime. Rocio Daga (p 61, Loi et droits naturels en Islam ?, Communio, p 56-62) montre que cette obligation est d’autant plus difficile à percevoir que le Coran (2, 216) explique que le combat rebute les croyants : « aussi bien se peut-il que vous répugniez à une chose et qu’elle soit pour votre bien ; il se peut que vous en chérissiez une autre, et qu’elle soit pour votre mal ».
 Le discours des jihadistes, selon Jean Birbaum (p 202), présente « les musulmans comme les opprimés par excellence dont le combat spirituel relèvera de sa déchéance l’humanité tout entière ». Ainsi, disent-ils (p 206) « Quand le royaume de Dieu sera advenu, il n’y aura plus ni musulman ni mécréant, ni chrétien ni athée, seulement des âmes bienheureuses ».
Le discours des jihadistes, selon Jean Birbaum (p 202), présente « les musulmans comme les opprimés par excellence dont le combat spirituel relèvera de sa déchéance l’humanité tout entière ». Ainsi, disent-ils (p 206) « Quand le royaume de Dieu sera advenu, il n’y aura plus ni musulman ni mécréant, ni chrétien ni athée, seulement des âmes bienheureuses ».
Jean Birnbaum dessine les parallèles et les dissemblances entre les parcours des jihadistes et des combattants des brigades internationales en Espagne (1936) aux pages 177-216. Les similitudes s’arrêtent (p 216) quand « ce militant [de gauche] entend le jeune jihadiste glorifier la mort ». En effet, « il ne peut plus le voir que comme un ennemi absolu, tant l’identité subjective de la gauche se confond avec l’amour de la vie, du bonheur et rien d’autre, ici, maintenant ». Dans un rapprochement peut-être audacieux, Jean Birnbaum rappelle que « Viva la muerte […] était le cri de ralliement des franquistes, qui se réclamaient eux aussi de la religion, chrétienne cette fois ». André Malraux décrivait ce combat franquiste comme devant imposer « l’ordre à coup de cimetières » (p 213). Les jihadistes eux, aiment autant la mort que « nous aimons la vie », une mort sur la voie de Dieu (p 212), s’appuyant sur la sourate 57, versets 20-21. Il faudrait évidemment avoir des certitudes sur ce qu’est la voie de Dieu !
Textes et interprétation
Adrien Candiard (p 31) analyse les prescriptions coraniques. La charia, le droit musulman, « désigne la volonté de Dieu, ses commandements » (p 33). Il n’écarte pas la question de l’interprétation des sources du droit musulman (p 101-104) donc, notamment, le Coran et les hadits de Mohamed/Mahomet, le prophète de l’islam. Pour lui, il s’agit d’ « une procédure juridique » non d’ « une attitude face à la vie », et cette procédure n’a jamais été interdite.
Pourtant, Rocio Daga (p 60) affirme qu’ « à partir du Xe siècle, on établit par consensus que les bases de la loi étaient déjà fixées. Du coup, on ferma les portes de l’interprétation individuelle et indépendante (bab-al-ijtihad). La production légale se réduisant à l’étude et au commentaire des œuvres qui existaient déjà. Aucune nouvelle réglementation légale ne fut plus considérée comme licite ». Maurice Borrmans (p 84) semble favorable à cette thèse « d’une ankylose multiséculaire » lorsqu’il cite des nationalistes et des auteurs d’ « une réinterprétation apologétique de l’islam » aux XIXe et XXe siècles. Dans son analyse sur l’Algérie des années 1990, Mgr Henri Teissier (p 449) reprend celle de Mustapha Cherif et écrit que « les islamistes […] ont tendance à remplacer l’adoration de Dieu par la vénération de la charia […] »
Rocio Daga (p 58) explique que pour les théologiens musulmans du Moyen Âge, « le crime pourrait être licite si Dieu le permettait », montrant par-là que Dieu ne le permet pas. Il resterait, là aussi, à définir le crime. Adrien Candiard (p 97) rappelle que la difficulté réside dans le fait que le Coran est, selon le dogme, « la parole même de Dieu, révélée directement à Mahomet ». Le Coran n’est pourtant pas intemporel selon l’exégèse (p 99) : la révélation a eu lieu « dans des circonstances précises de la vie de Mahomet et de sa communauté, et [ses prescriptions] viennent résoudre des difficultés ou des questions particulières ».
Le lecteur du Coran, selon Adrien Candiard (p 28-29), ne cherche pas forcément un sens ou un enseignement. Le livre « rend Dieu présent, parce qu’il est la présence divine même, dans la récitation » et « il est la parole même de Dieu, éternelle, sans changement, sans auteur humain ». Philippe Cormier (p 55, Sur le sens du Coran incréé, Communio, p 48-55) écrit que « Le son des mots ne fait pas sens, il est sens ». Il souligne (p 52) que « Le Coran fonctionne comme méta-texte au terme de la série des livres révélés en différentes langues et cela non seulement eu égard au signifié mais – c’est le point décisif – à la lettre ». Tandis que (p 50) « la Bible demande […] à être interprétée à la lumière du Coran, en fonction de sa conformité au Livre de l’Islam ». Rémi Brague (p 13) souligne « qu’il ne suffit nullement d’ouvrir le Coran pour être fixé sur tel ou tel point de doctrine ou de pratique » et (p 15-16) que le statut du texte (celui de la révélation divine pour les musulmans) est différent de celui de la Bible qui est l’histoire de la relation entre Dieu et le peuple d’Israël, et le témoignage des apôtres.
De son côté, Philippe Cormier (p 52) décrit ainsi le littéralisme : « soit donc le texte est clair et n’a pas lieu d’être interprété, soit il est obscur et doit être obéi dans un esprit de soumission confiante ». Pourtant, prétendre nier la nécessité d’une interprétation du Coran en pratiquant le littéralisme, c’est justement donner « une méthode de lecture et d’interprétation : le littéralisme » affirme Adrien Candiard (p 26-27). Historiquement, des interprétations ont changé à travers les siècles et (p 58-59) Le littéralisme est combattu dans l’islam même par Mohamed al-Ghazali (XIIe siècle) par exemple. Jean Birnbaum (p 47) appuie cette idée de la variété des lectures possibles.
Le salafisme
Adrien Candiard (p 64-70) présente le salafisme, en référence aux salaf, les anciens pieux des trois premières générations de musulmans, comme un mouvement de réforme, puisant dans ces premières générations une source de renouveau à la fin du XIXe siècle. Il refuse la tradition « au nom d’un rapport direct à l’origine ». Ce mouvement rencontre le wahhabisme né dans le désert d’Arabie au XVIIIe siècle : « islam bédouin, à la fois très simple et très rigoriste, loin de la décadence de l’islam des villes ». Il est sectaire et rejeté avec mépris par les autorités intellectuelles. La famille Saoud, qui fonde en 1932 le royaume qui porte son nom, adhère et promeut le wahabbisme. Le mouvement né de cette rencontre se répand en raison des moyens financiers de l’Arabie Saoudite. Le jihadisme contemporain vient toujours du salafisme mais il n’y a pas identité entre les deux. Le salafisme n’est pas toujours violent. La majorité des adeptes sont « quiétistes, se désintéressent de la politique, et prônent la soumission aux autorités ».
Pour Adrien Candiard (p 70-71) l’islam salafiste n’est pas l’islam des origines mais son imitation. Il n’est pas non plus la vérité de l’islam mais l’un de ses visages, à « l’influence […] grandissante, dans le monde arabe comme en Europe ». Le salafisme a des réponses claires aux aspirations politiques et sociales (contre la démocratie, contre les droits de l’homme…) ce que n’ont pas les autorités de l’islam classique. A contrario, les islamistes du type frères musulmans « n’ont pas de véritable contre-modèle à opposer à la modernité ; ils cherchent surtout à islamiser la modernité » (p 79).
L’urgence, selon Adrien Candiard (p 74) n’est pas, pour l’islam, de rompre avec sa tradition mais au contraire de retrouver un rapport apaisé, constructif, avec sa tradition ». Selon lui (p 118-119), il ne faut pas attendre un « islam modéré » ou des « musulmans modérés » comme si nous attendions « des gens modérément musulmans » en donnant l’impression que « les salafistes sont davantage musulmans que les autres ».
Des perspectives
D’une manière générale, Adrien Candiard (p 118) souhaite en France plus d’étude de théologie, musulmane, chrétienne et naturelle. Dès les pages 12-13, il écrit, « mais enfin, il faut que chacun s’y mette dans son domaine : la géopolitique, l’histoire, la sociologie, la psychiatrie mais aussi la théologie musulmane ». La nécessité d’une meilleure « connaissance de l’islam chez les chrétiens, et du christianisme chez les musulmans » était déjà soulignée par Rémi Brague (p 10). Elle est plus nécessaire, selon Adrien Candiard (p 74 et aussi 97-98), qu’un aggiornamento de l’Islam que Jacques Jomier, pourtant, appelle en 1991 (p 79). Jean Birnbaum, enfin, suivant son point de vue d’étude de la gauche française (p 158) affirme que « pour faire face au défi du religieux, les gens de gauche devraient donc se pencher sur les textes fondateurs des monothéismes et sur leurs divers contenus doctrinaux ».
Nota : un certain nombre de termes, écrits de manières différentes selon les auteurs, ont été harmonisés. C’est, par exemple le cas de djihad et jihad dont la dernière graphie, la plus simple, a été retenue.
Luc-André Biarnais archiviste du diocèse de Gap et d'Embrun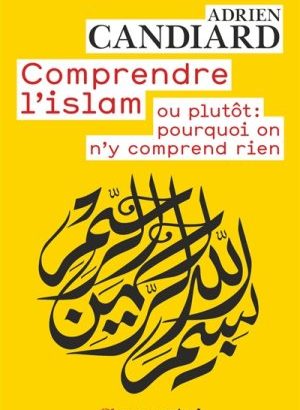
2 comments